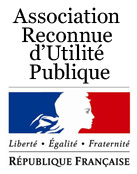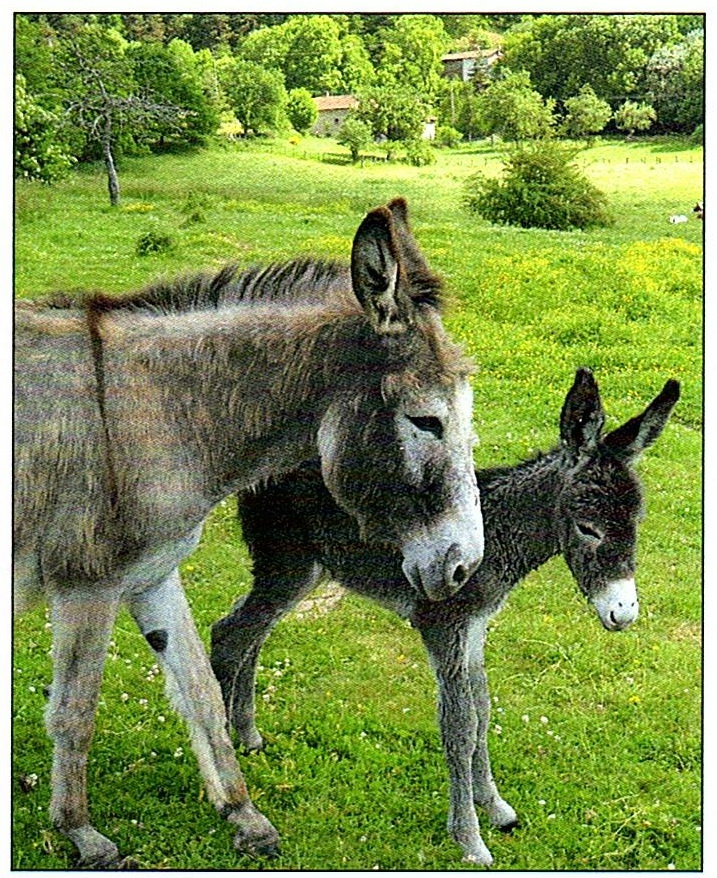2013 et ce début 2014 sont incontestablement caractérisés, sur le plan climatique, par une pluviométrie importante et un décalage des saisons, avec un hiver à rallonge qui a perturbé la nature.
C’est l’occasion pour moi dans cet article de rappeler l’intérêt de la vermifugation au regard de la climatologie. Incontestablement les conditions climatiques, humidité et températures douces, sont propices à un risque plus important d’infestations parasitaires internes. Sans vouloir reprendre dans le détail mes articles (n° 45 Mars 2002 – n° 77 Mars 2010 – n° 67 Septembre 2007), je voudrais vous faire un rappel sur les parasites, l’équilibre entre l’âne et son hôte parasite, la vermifugation.

1. Tête de tænia solium et crochet – 2. Tête de tænia inerme
3. Tête de Botriocéphale – 4. Ascaride lombricoïde
5. Tête de l’ascaride (coupe horizontale) – 6. Oxyure
7. Trichocéphale – 8. Anguillule – 9. Amibe – 10. Balantidium
11. OEuf de tænia – 12. OEuf de lombric – 13. OEuf d’oxyure
14. OEuf de trichocéphale – 15. OEuf d’anguillule – 16. Larve d’anguillule
Extrait du catalogue de 1938 de la Fabrique Spéciale
de Produits Vétérinaires des Et. Adrien SASSIN (Orléans/Alger)
I – LES PARASITES INTERNES
1 – Parasites du tube digestif
Ils sont les plus nombreux et en cas d’infestation importante, ils se traduisent par l’apparition de troubles digestifs : ramollissement des selles, diarrhées entérites et sans traitement rapide anémie, amaigrissement. Tout cela faisant apparaître un poil piqué sur un animal ayant perdu sa gaieté et sur le plan général, un âne fragilisé par une diminution de ses défenses immunitaires.
En premier, je veux citer les Strongles, qui sont de véritables « brouteurs de muqueuse » et en cas d’infestation massive provoquent des troubles digestifs graves avec amaigrissement et risque important de mortalité. Les larves au cours de leur migration peuvent atteindre le foie, les artères intestinales. Les petits strongles attaquent la paroi intestinale avec une période très critique à la sortie de la muqueuse. Les gastrophiles ou oestres comme leur nom l’indique vivent dans l’estomac, attaquent la muqueuse la dégrade et peuvent entraîner l’apparition d’ulcères. La particularité de ce parasite est le fait que les pupes excrétées au printemps donnent naissance à des mouches qui pondent en été sur le poil et par léchage, l’âne infecte son estomac.
L’entretien régulier du poil, brossage, désinsectisation font partie de la prévention. A un degré moindre, je citerai les ascarides parasites des jeunes et des vieux. Ce sont des vers très longs et pointus qui se développent au niveau de l’intestin grêle. Les traitements préventifs sont surtout à préconiser chez les jeunes avant le sevrage. Les oxyures sont des parasites plus anodins avec une ponte des femelles aux marges de l’anus entraînant des démangeaisons assez caractéristiques. Enfin, les cestodes, ténias, plus rares peuvent entraîner un amaigrissement important.
2 – Parasites de l’appareil respiratoire
Les Dictyocaules sont des parasites très répandus chez les ânes et on considère que 50 % de nos amis en sont porteurs, mais même s’ils les tolèrent bien au contraire du cheval, nous pouvons avoir des phénomènes de toux et dans certains cas de pneumopathies. Les adultes vivent dans les grosses bronches, les larves excrétées sont éliminées par les crottins dans les pâturages. La contamination se refait par l’ingestion d’herbe.
3 – Autres parasites internes
Pour mémoire, rappelons la Douve, les filaires de la peau, les onchocerques des tendons, les habronèmes avec en particulier les habronémones décrites dans les plaies d’été. N’oublions pas de citer les piroplasmes qui sont des parasites du sang. Les piroplasmoses sont rencontrées surtout dans les régions du Sud, mais peuvent exceptionnellement se rencontrer partout et souvent sans symptômes précurseurs caractéristiques.
II – L’ÉQUILIBRE ENTRE L’ÂNE ET SON HÔTE
Il faut admettre que le « zéro parasite » n’existe pas et qu’un équilibre entre l’animal et le parasite est souhaitable pour maintenir une population résiduelle qui entretient l’immunité. Le tout est d’éviter un parasitisme important et l’apparition de manifestations cliniques. La tolérance varie en fonction du parasite.
Les dictyocaules sont acceptés par l’âne jusqu’à un niveau plus élevé que chez le cheval, par contre la douve ne doit avoir aucune tolérance.
La tolérance varie avec l’âge, en particulier pour les ascaris.
Enfin sur le plan général la tolérance va dépendre de l’état de l’animal, un cas de malnutrition va réduire les capacités de tolérance. L’apparition objective de cette tolérance est l’examen coprologique qui va permettre de compter un nombre d’oeufs par exemple. Je rappelle que l’on peut considérer que 200 oeufs de Trichostrongylus oxei ne nécessitent pas de traiter.
Par contre au-delà de 400 à 500 oeufs il est indispensable de mettre en place une thérapie. L’appréciation subjective consiste à vérifier que les crottins restent normalement secs, sans mucus, que l’animal n’est pas amaigri
avec un poil luisant.
L’indication du traitement va donc tenir compte des risques de la perte de cet équilibre : âne-parasite. Je vous rappelle que si le traitement peut-être indispensable, la prévention elle est absolument indispensable.
III – PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT
Tout d’abord la prophylaxie sanitaire qui consiste à la rotation des pâturages, au ramassage des crottins, au drainage des terrains trop humides. Si l’on peut, il faut pratiquer la rotation lente des pâtures avec deux passages sur une même parcelle à quatre mois d’intervalle, cela permet une décontamination naturelle de la prairie. Il faut utiliser les prairies temporaires après les coupes de foin.
La prophylaxie passe aussi par la mise en quarantaine de tout animal introduit, mesure importante en particulier pour analyser par coprologie l’éventuelle présence de souches résistantes. Enfin la prophylaxie va consister à désinfecter les boxes, les aires de pansage avec un jet haute pression et haute température pour détruire les oeufs. Même précaution pour le matériel de pansage (surtout pour les parasites externes).
Je veux citer également des possibilités de prophylaxie par utilisation des plantes.
En ce qui concerne les huiles essentielles je suis plus réservé car elles peuvent être irritantes et ne pas être utilisées à l’état pur. Il peut y avoir de bonnes utilisations mais attention aux charlatans. Après avoir pris en considération tous ces éléments ce sera d’une manière raisonnée que la décision de traiter sera prise.
Compte tenu des conditions climatiques de cette année, il me semble opportun de pratiquer un traitement. Votre vétérinaire est le mieux placé pour vous indiquer le produit à utiliser avec un objectif de ne pas provoquer l’apparition de souches résistantes et donc de voir avec lui la rotation des molécules utilisées en cours d’année, voir avec lui la répétition éventuelle au bout de 4 à 6 semaines du traitement.
Je ne peux que vous recommander de faire une bonne utilisation du médicament en respectant la posologie. Un surdosage peut entraîner et favoriser la création de souches résistantes. A vous de connaître le poids de votre animal. Je vous renvoie aux deux articles que j’ai écrit pour avoir une idée juste du poids de votre ami aux grandes oreilles. A vous de bien vérifier que l’âne a bien absorbé la pâté introduite dans la bouche.
Pour les élevages collectifs, il faut recommander de traiter tous les animaux le même jour pour réduire la contamination des pâturages.
En espérant que vous ferez partie des éleveurs, propriétaires qui pratiquent des « traitements raisonnés » afin de diminuer la pression parasitaire et éviter l’apparition de troubles cliniques tout en maintenant une population résiduelle qui entretient l’immunité. Ensemble, avec votre vétérinaire, protégeons nos amis de la maladie parasitaire et essayons de contribuer à éviter les résistances aux antiparasitaires qui suivent le développement des antiparasitaires comme une ombre à l’identique de la résistance des bactéries aux antibiotiques.
Asînement vôtre, Jacques ROSET
Extrait du N° 92 de la revue de l’Âne Bleu